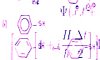HERVE ARRIBART (HA) : Pouvez vous retracer votre formation, vos débuts dans la carrière ?
PAUL HAGENMULLER (PH) : Depuis que je m’intéresse à la science je me suis préoccupé de la physique. Je me suis demandé pourquoi les matériaux avaient telle ou telle couleur, tel ou tel comportement électrique, magnétique, optique ... J’ai donc été porté vers la physique, plus tard vers la mécanique par extension, dès que j’ai entrepris mes études de science. Ces études ont eu lieu en 1940 à l’université de Strasbourg, repliée à Clermont Ferrand. Mon statut était celui d’un réfugié politique puisque j’avais quitté l’Alsace pour échapper au système politique allemand et parce que je me refusais d’être un jour mobilisé dans l’armée allemande. A Clermont, pour des raisons financières j’ai fait le choix de la chimie, séduit par la diversité des méthodes de préparation mais choqué parce que la chimie était alors très descriptive et n’était pas encore une science déductive, de réflexion.
Sur place, je suis entré en résistance, je faisais du sabotage. J’ai été arrêté en 1943 et envoyé en camp de concentration à Buchenwald. Là j’ai appris à me taire. J’ai travaillé sur les V2. J’ai appris le russe avec les prisonniers russes ; j’avais de bons contacts avec les communistes allemands. Puis j’ai été envoyé à Dora où c’était plus dur.
Après la guerre, André Chrétien m’a proposé un sujet de thèse sur la formation de nitrites complexes en solution aqueuse, puis une recherche sur la réduction de divers oxydes par des hydrures d’alcalino-terreux. J’ai accepté parce qu’il y avait un appareil mathématique. Puis au lendemain de ma thèse je me suis dit : il faut que je travaille sur des choses plus concrètes, les matériaux. J’ai voulu revenir à mes anciennes amours les matériaux. Je suis parti au Vietnam dans le cadre d’un accord avec la direction de l’enseignement supérieur et moi. Je partais pour deux ans 1954-56, au moment où la France se désengageait et voulait garder des relations culturelles. Au retour il était entendu que je pourrai choisir un poste de maître de conférences parmi ceux qui étaient disponibles en chimie. Ces deux ans de Vietnam ont été pour moi une période de décantation, de réflexion. Et quand je suis revenu j’ai voulu, d’une part, me préoccuper de physique ce qui suppose la détermination des structures atomiques - pour comprendre les propriétés physiques il faut savoir quelles sont les positions des atomes - et, d’autre part, il faut une certaine habileté à préparer des matériaux par des techniques nouvelles fort différentes.
HA : Quelles étaient alors les relations entre physique des solides et chimie des matériaux en France ?
PH : Aujourd’hui la physique s’est beaucoup rapprochée de la chimie parce que, de part et d’autre, on a compris que c’était indispensable pour faire des matériaux à propriétés spécifiques intéressantes sur le plan de la science fondamentale et intéressantes aussi sur le plan des applications. Au début des années 60, on en était à se chercher. Moi, j’avais fait un choix très clair : faire une chimie orientée vers la physique, plus tard vers la mécanique. Maintenant c’est devenu presque de routine, ne serait-ce que par ce que les chimistes pour bien connaître leurs matériaux sont obligés d’utiliser des méthodes de caractérisation physiques. La physique s’est imposée dans les perspectives de la recherche comme par les nécessités quotidiennes : savoir où sont les atomes et les électrons.
Donc au retour du Vietnam mon objectif était d’associer la physique et la chimie. J’ai eu la chance que dans mon poste à Rennes il y avait quantité d’excellents étudiants, mais en chimie personne ne voulait faire de la recherche sous prétexte qu’il n’y avait pas de moyens. J’ai décidé que j’allais lancer des thèses dans ce domaine à l’interface de la physique et de la chimie. On a d’abord tâtonné. On a travaillé sur le bore, sur les hydrures. Parmi les études réalisées à Rennes se trouvait la réduction d’oxydes par l’hydrure de lithium. On était intéressé par les hydrures de bore et d’aluminium qui comportaient des liaisons dites pont-hydrogène originales. Ceci m’a donc amené à réduire le V2O5 par l’hydrure de lithium et nous avons constaté qu’il y avait des phases intermédiaires qui devaient être les futurs bronzes de vanadium et de lithium, qu’on a appelées plus tard b et g. La phase a étant la solution solide de lithium dans V2O5. Alors j’ai pensé que ces matériaux étaient intéressants : s’il y a là un domaine d’existence, les propriétés physiques doivent varier à l’intérieur de ce domaine et si, par chance, ce domaine est suffisamment grand on peut faire ce qui est plus difficile dans les solutions solides limitées, de type oxydes non stœchiométriques. On s’est préoccupé de manière systématique des bronzes de vanadium qu’on a préparés par voie synthétique. Dans les années qui ont suivi - de 1960 à 70, j’étais alors à Bordeaux où un grand nombre de chercheurs de Rennes m’avaient suivi - on a préparé un grand nombre de phases de bronzes de vanadium par analogie avec les bronzes de tungstène qui avaient déjà été signalés. On a fait systématiquement des études magnétiques et électriques pour caractériser le mode de conductivité. Il est apparu que lorsqu’on insérait le lithium dans le réseau, on remplissait les états électroniques du vanadium, qui forment la bande de conduction. Les électrons devenaient donc de plus en plus délocalisés au fur et à mesure que leur nombre augmentait et on passait d’un état semi-conducteur à l’état métallique.
BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT (BBV) : Quelles étaient vos relations avec le groupe de Robert Collongues ?
PH : Collongues avait été élève de Georges Chaudron, comme André Michel, Paul Lacombe, Jacques Bénard. J’avais d’excellentes relations avec Collongues. Nos domaines se recouvraient partiellement sur la non-stœchiométrie mais on avait des approches différentes. Lui enlevait des ions, nous on faisait de la chimie d’insertion. Collongues aimait bien se singulariser par rapport à moi mais dans la pratique nous avions la même politique sur des matériaux différents. Il y avait chez lui le même désir de systématique et de réflexion en profondeur. Collongues considérait que la bonne expérience était importante mais qu’elle devait illustrer une réflexion de fond. Il pensait que la science était avant tout la réflexion intellectuelle.
J’ai fait de la chimie sous pression à la manière d’un tailleur : choisir une structure cristallographique, écrire la formule d’une composition chimique, puis la stabiliser dans un degré d’oxydation élevé. Après avoir discuté la structure puis la formule, on préparait sous haute pression. C’était du design pour la conductivité électronique, les propriétés magnétiques, ou les propriétés magnéto-optiques et plus tard également pour la conductivité ionique.
Nous nous intéressions systématiquement à l’évolution de toute propriété physique originale en fonction de la composition et de la structure. Un nœud important dans cette évolution fut le colloque organisé à Bordeaux en 1964 sur les oxydes d’éléments de transition.
HA : Quelle fut la portée de ce colloque de 1964 ?
PH : Ce fut le moment où s’est constituée une communauté internationale de chimie du solide. Le colloque a rassemblé les chimistes qui nous étaient familiers, des cristallographes (Erwin-Felix Bertaut, Charles Guillaud), des physiciens (Jacques Friedel). Parmi les étrangers Mike Sienko, John Goodenough du Lincoln Laboratory au MIT qui est venu pour la première fois à Bordeaux ; des Allemands : Wilhelm Klemm, Rudolf Hoppe, Harold Schäfer ; des Hollandais, des Belges, etc. Il est apparu qu’une conjugaison des méthodes de mesure physique, des méthodes de détermination structurale et une certaine flexibilité pour les changements de composition, pouvaient permettre d’optimiser un certain nombre de propriétés physiques. D’abord le magnétisme, ensuite il y a eu la ferro-électricité - comment accroître la distortion ferro-électrique et par voie de conséquence la polarisation ; enfin, la conductivité ionique, d’abord dans des matériaux isolants au point de vue électronique et ensuite dans des matériaux dits cathodiques utilisables dans des batteries parce que conducteurs mixtes.
Je dois dire que ce qui fut déterminant pour l’avenir de la chimie du solide ce fut la venue de John Goodenough à ce congrès parce qu’il a popularisé parmi nous l’idée de l’importance de la liaison chimique. On a compris qu’on pouvait renforcer ou atténuer la liaison chimique en modifiant la composition, en particulier en jouant sur la liaison antagoniste. Par exemple si on compare le zirconate de baryum avec le titanate de baryum, la liaison baryum-oxygène est renforcée dans le zirconate par rapport au titanate. Inversement si on remplace dans le titanate de baryum, le baryum par le strontium comme la liaison strontium -oxygène est plus forte que la liaison baryum-oxygène, la liaison titane-oxygène est affaiblie, ce qui peut amener une variation très forte de la polarisation en fonction de la température, juste en dessous de la température de Curie. Et on peut avoir ainsi des matériaux aux propriétés intéressantes.
HA : Le rapprochement de la physique et de la chimie avec une orientation vers les applications constituerait-il donc l’identité de la chimie du solide à cette époque ?
PH : Oui nous avions un besoin civique de justifier les crédits que nous demandions par une application dans la vie économique. De plus, le travail avec des industriels fait naître des problèmes inattendus qui sont des challenges et qui sont nourrissants.
Une deuxième date importante dans l’institutionnalisation de la chimie du solide est 1978. Sur mon initiative la Société française de Chimie a créé en 1976 une division de chimie du solide, dont j’ai naturellement été le président. J’ai organisé la même année un premier colloque national de chimie du solide à Nantes. Sur ma proposition et sous ma présidence s’est tenu à Strasbourg en 1978 le premier congrès européen de chimie du solide, organisé par Jean-Claude Bernier (Strasbourg a été choisi pour une raison stratégique,). L’intervalle entre deux congrès consécutifs est maintenant de 3 ans ; le huitième congrès européen a lieu en juillet 2001 à Oslo.
HA : Quel était l’état des relations entre science et industrie en France à cette époque ?
PH : Il y avait une tradition de collaboration en métallurgie et en chimie : Chaudron et ses élèves, Lacombe, Bénard étaient très impliqués. Robert Collongues l’était aussi dans le domaine des monocristaux. Mais il y avait une forte hostilité syndicale au nom des grands principes : il ne faut pas mettre la science au service des grands intérêts privés. Les choses se sont atténuées à la veille de l’élection présidentielle de 1981. J’ai eu la visite de M. Kahane, longtemps doyen à Orsay, qui s’était rallié à la collaboration avec l’industrie privée. Cela a facilité cette évolution qui, de ma part, ne rencontrait aucune résistance car j’étais un scientifique et je n’avais pas à me poser des problèmes de déontologie qui me paraissaient un peu artificiels. Mais une partie de mon entourage était réticente à travailler avec l’industrie.
HA : Est-ce la crise pétrolière de 1973 qui a contribué à anoblir le rapprochement entre science et industrie ?
PH : Oui. Du fait de notre préoccupation entre propriétés physique et composition, nous avons été conduits à travailler sur des composés non-stœchiométriques d’intercalation et nous avons constaté après 1973 qu’il y avait possibilité d’intercalation ou désintercalation à basse température grâce à l’électrochimie comme on le faisait aux Etats Unis. Exxon et Bell étaient plus concernés que nous par la crise de l’énergie.
Les recherches sur la conductivité ionique ont été encouragées par la crise de l’énergie. Après la zircone déjà exploitée par Nernst, puis étudiée par la NASA et par Collongues ; il y avait eu AgI. Puis il y a eu l’alumine-b qui a suscité de nombreux travaux. CGE a dépensé beaucoup d’argent. L’alumine-b est un matériau très particulier. J’étais très sceptique. On a abaissé la température de fonctionnement, mais c’est encore trop haut pour un véhicule électrique. Et puis le soufre attaque la membrane. Finalement on a renoncé, pensant qu’avec des batteries au lithium on irait plus loin. Les derniers efforts de développement visaient plutôt le stockage d’énergie en période creuse. Les nasicons eux ne sont pas attaqués et ils présentent un avantage au plan fondamental car leur structure est plus simple. Ils ont de bonnes performances, qu’on pouvait maîtriser avec une juste proportion de sodium.
HA : Pouvez vous évoquer vos travaux sur la conduction ionique ?
PH : Avant 1973, on a publié un grand nombre de documents sur des conducteurs ioniques. On s’inspirait comme modèle de réflexion des bronzes de tungstène bien que la plupart des travaux publiés à l’époque fussent des études structurales et que les bronzes de tungstène soient métalliques. On avait également préparé une série de nouveaux bronzes de tungstène. Ce travail s’est étendu à des bronzes oxyfluorés, à des bronzes de vanadium et de molybdène contenant les deux cations vanadium et molybdène plus le sodium et le lithium. Puis au début des années 1970, on s’est attaqué aux premiers bronzes de manganèse NaxMnO2 et puis aux bronzes de cobalt KxCoO2.
Sur ces entrefaites il y a eu la grande crise pétrolière de 1973. Les pays occidentaux ont eu peur de manquer d’énergie et donc on s’est occupé de sources d’énergie non fossile et de stockage d’énergie. Un certain nombre de gens ont voulu faire des batteries. Exxon et la Bell Telephon, Whittingham et Murphy en particulier, ont travaillé sur ces matériaux non plus comme nous l’avions fait vers 500°C avec des phases en équilibre thermodynamique mais à basse température par intercalation ou désintercalation électrochimique.
Une spécialité à Bordeaux c’était les fluorures conducteurs. On remplaçait systématiquement l’oxygène par du fluor parce qu’il a la même taille et présente une liaison plus faible. On pouvait ainsi atténuer les interactions magnétiques. Comme pour la zircone, on dope les fluorures systématiquement. Watanabe avait déjà préparé les premières batteries au fluor.
Jean Rouxel s’était intéressé à l’époque où il était mon élève aux sulfures, aux sulfures à couche en particulier. Entre les couches de FeOCl et FeSCl par exemple, on pouvait intercaler beaucoup de choses, comme l’ammoniac ou les amines. Jean Rouxel a préparé NaxTiS2, un matériau qui avait été préparé par Rudorf à Fribourg, qui le considérait comme une curiosité. Mais Rouxel a très vite réalisé qu’il devait y avoir un domaine d’existence. Or il s’est avéré que Li xTiS2 avait un large domaine d’existence. Jean Rouxel a poussé dans cette voie et il a étudié un grand nombre de sulfures et sélénures à feuillets alors que nous nous intéressions plutôt aux oxydes. Il y avait une sorte d’accord empirique entre nous : Nantes les sulfures, Bordeaux, les oxydes. Nous avons étudié des matériaux sur le plan de la synthèse, dans des conditions d’équilibre thermodynamique plus que par intercalation désintercalation.
Il y a une grande variété de méthodes topologiques ou non de relative basse-température qui permettent d’obtenir des matériaux nouveaux. Mettre un mélange très fin de poudres sous hautes pression pour que se déclenche une réaction brutale qui prend fin lorsque l’un des deux constituants initiaux a disparu. Donc c’est un échauffement brutal suivi d’une trempe. Ce qui permet d’obtenir des borures ou des silicium stables seulement à haute température.
Beaucoup de ces matériaux sont métastables mais on peut les utiliser dans des dispositifs.
Jean Rouxel a apporté beaucoup dans le domaine des réactions d’intercalation-désintercalation. Les oxydes lorsqu’on les désintercale perdent des électrons cationiques. C’est une oxydation cationique. Lorsqu’on part de LixCoO2 vers CoO2 on perd des Li+, mais on perd également des électrons qui proviennent des niveaux d. Mais pour les séléniures, ce sont les niveaux anioniques qui sont les plus élevés. Et lorsqu’on oxyde, c’est l’anion qu’on oxyde. On passe de Se2- à Se- et de Se- à Se pour des raisons de stabilité de liaison. Et Jean Rouxel a montré qu’il y avait une évolution graduelle pour les éléments 3d à l’état de sulfure entre TiS2, qui a une structure à couches, et CuS2 qui a une structure avec un ion S de type pyrite. Il a fait une analyse précise dans les cas douteux où les niveaux cationiques et anioniques sont à peu près de même énergie. L’analyse très fine des distances inter-atomiques lui a montré si c’était le cation ou l’anion qui était oxydé. Il a également fait beaucoup de choses sur les bidimensionnels qui sont ici hors sujet.
HA : Qu’est-ce qui a manqué en France alors que les compétences étaient là pour donner l’impulsion sur les batteries au Lithium ?
PH : Il y a un très grand nombre de batteries réversibles au lithium pour des applications diverses depuis les montres jusqu’aux batteries de taille moyenne utilisées par les militaires pour observation spatiale avant bombardement. Mais le marché important, c’est le véhicule électrique, non polluant. Du moins en partie car on s’est résigné au véhicule hybride. Le véritable marché ce serait la voiture électrique -éventuellement hybride- ce qui suppose des batteries de grande taille. Probablement l’électrolyte sera un polymère PEO imprégné d’un sel de lithium avec un gros anion, type matériau Armand. La cathode sera probablement riche en cobalt ce sera un matériau voisin de LixCoO2, plutôt un oxyde qu’un sulfure parce que la tension est plus élevée. Mais pour l’anode ce n’est pas encore évident. Si on pouvait faire mieux que les composés d’intercalation du lithium on serait content. Mais actuellement il n’y a pas encore de solution. Il y a donc premièrement un problème de matériau qui freine cette évolution. Deuxièmement il y a un problème de prix. Ajoutez à cela qu’une batterie au lithium doit être scellée car le lithium est sensible à l’atmosphère et vous voyez que ce n’est pas évident. Une solution concurrente est la batterie hydrogène consistant à stocker l’hydrogène dans un alliage métallique et puis à libérer l’hydrogène. Ce modèle permet des puissances plus élevées que la batterie au lithium mais là aussi il y a un problème de vieillissement car après un certain nombre de cycles, l’alliage s’oxyde car l’oxyde est plus stable que l’hydrure. Ce problème n’est pas encore résolu avec un coût acceptable pour l’utilisateur. A cet égard, il y a une coupure entre le scientifique et l’utilisateur.
HA : Concernant les relations entre physique et chimie qu’est-ce qui a favorisé le rapprochement ?
PH : Les physiciens ont fait des efforts pour parler un langage plus proche de celui des chimistes. J’ai parlé déjà de John Goodenough. Nevil Mott aussi était un homme qui s’exprimait dans un langage compréhensible pour un chimiste. Par exemple, lorsqu’il a obtenu des transitions isolantes par changement de composition au sein d’un domaine d’existence, on comprenait ses préoccupations et il comprenait les nôtres bien qu’on raisonne sur des modèles un peu différents. On est ainsi arrivé à préparer dans des bronzes de tungstène oxyfluorés des matériaux qui sans changement de structure manifestaient une transition métal-isolant. Les physiciens ont fait des progrès. L’équipe de Friedel était très préoccupée de parler un langage qui nous était commun. Je pense à Denis Jérôme, Claude Berthier à Grenoble.
HA : Le travail de physiciens sur la caractérisation très fine vous a-t-il aidé ?
PH : Je me souviens de discussions à Orsay sur les hexaborures. Les physiciens voulaient des matériaux qu’on appelait thermo-ioniques - mais c’est un mot malheureux : on devrait plutôt dire thermo-électronique - c’est à dire ayant un faible potentiel d’ionisation et susceptibles de cracher un jet d’électrons relativement puissant sous tension faible. On en a fait une étude systématique et on a essayé de préparer des cristaux.
HA : Et quel était l’enjeu ?
PH : L’enjeu était d’avoir ponctuellement un faisceau d’électrons puissant, par exemple pour des soudures, des soudures localisées. Outre la collaboration avec les physiciens d’Orsay on a aussi collaboré avec ceux de Grenoble. Plus que ceux d’Orsay, les physiciens de Grenoble avaient un langage très compréhensible. Il y avait un grand homme à Grenoble, Louis Néel. Il avait publié son travail sur le ferrimagnétisme en s’appuyant sur des modèles structuraux très clairs. La répartition des cations entre les sites tétraédriques et les sites octaédriques de la structure spinelle. Donc on comprenait pourquoi on avait des interactions d’abord anti-ferromagnétiques - ce qui constitue la base du ferrimagnétisme - entre des sites tétraédriques A et des sites octaédriques B, et pourquoi l’aimantation résultante était accrue lorsque le réseau prévalent contenait des cations avec beaucoup d’électrons d célibataires. Tous ces travaux - encouragés par les recherches militaires - ont permis une collaboration très fructueuse avec Grenoble. Je pense à Bertaut en particulier. Nous avons été encouragés, par exemple, à faire des études basse-température par Pauthenay qui nous a dit : c’est aux basses- températures qu’on détecte les phénomènes peu énergétiques.
Alors c’est l’époque où nous avons manqué le prix Nobel - Je dis cela en plaisantant, bien sûr !-. Nous avons préparé les premiers oxydes purs de Cu3+ : par exemple SrLaCuO4. Nous avions une telle habitude des solutions solides qu’on pouvait imaginer de préparer une solution solide avec La2CuO4 contenant du Cu2+. Mais pour nous, les solutions solides, c’était du travail secondaire. On cherchait à préparer des oxydes purs. Si on avait été préoccupé des solutions solides on aurait pu trouver des oxydes contenant à la fois du cuivre Cu 2+ et 3++. Comme par routine on caractérisait tous nos matériaux jusqu’à la température de l’hélium liquide, on aurait trouvé la supraconductivité. On ne l’a pas fait parce qu’on voulait des phases pures et non pas des solutions solides.
Bernard Raveau l’a fait avant Alex Müller. Il avait un objectif : comprendre ce qui se passait au point de vue des corrélations. Passer d’un semi-conducteur à un métal. Müller était un très grand physicien. Il a été surpris aussi mais il a tout de suite expliqué. Raveau a fait ses solutions solides. C’est même moi qui ai transmis sa publication au M[aterials] R[esearch] B[ulletin] mais j’ai regretté à l’époque qu’il n’ait pas fait de mesure à l’hélium liquide.
HA : Après avoir évoqué vos collaborations en France, pourriez vous parler de vos liens avec l’étranger ? Vous avez été précurseur pour les relations scientifiques avec les pays en voie de développement comme la Chine, le Maroc et l’Inde. Quelles étaient vos motivations ? Comment voyez-vous la science des matériaux dans ces pays ?
PH : J’ai toujours été persuadé que la science devait être internationale. Cela me distingue de beaucoup de mes compatriotes. Je suis toujours étonné que l’on fasse des quêtes pour aider la recherche en France sur le SIDA. Toute la recherche sur le SIDA, toute recherche de pointe est internationale et ce n’est pas parce que la France dépensera un peu plus d’argent que nécessairement, il y aura des progrès significatifs. La science doit être internationale.
J’ai donc eu des liens d’abord avec les pays développés car dans ce type de relation on se fait connaître mais aussi on apprend. Je suis allé souvent aux Etats Unis, moins par enthousiasme culturel, que parce qu’on y rencontre des gens de qualité. J’ai rencontré Goodenough, Al Cotton... j’ai rencontré à Berkeley ou à Stanford des gens de grande qualité. J’ai eu des relations suivies pendant un temps avec la Grande Bretagne mais les Anglais ont un sentiment de quant à soi. J’espère qu’avec le temps la Grande Bretagne va évoluer vers une intégration dans l’Europe. Les Allemands sont très favorables à cette intégration. Dès 1961 j’avais pris l’initiative d’emmener tout mon laboratoire en Allemagne pour un voyage de 15 jours. On est allé à Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Darmstadt, Giessen, Göttingen etc.. On a été très bien reçu par Wilhelm Klemm avec qui j’ai toujours entretenu d’excellentes relations. Mais ses élèves étaient jaloux. Les Allemands se sont sentis bousculés parce qu’un peu jaloux de gens qui faisaient beaucoup de bruit. Ils avaient une bonne tradition de chimie préparative, en relation avec l’industrie. Les Allemands ont compris que pour faire des matériaux nouveaux il fallait des techniques nouvelles comme la haute pression. Mais leur but c’était la performance tandis que le nôtre c’était de stabiliser des structures électroniques peu usuelles, grâce à la synthèse. Les Allemands se sont senti un peu gênés. Les gens leur disaient : vous utilisez des équipements de haute pression mais ce que vous faites c’est de la botanique alors qu’il faudrait réfléchir. Le but d’un équipement est de faire des matériaux à façon pour répondre à des problèmes déterminés. Les collègues allemands avaient un autre point de vue et je regrette qu’il n’y ait pas eu davantage de liens.
En revanche, toujours parmi les pays développés, j’ai eu beaucoup de liens avec l’Europe de l’Est. Pour deux raisons. D’abord, il y avait des gens de qualité chez les Soviétiques, les Polonais et les Tchèques. De plus j’étais un peu agacé de cette Europe coupée en deux du fait de la guerre froide. Donc je trouvais raisonnable qu’il y ait une présence de la France là où c’était relativement facile, c’est à dire la science. C’était intéressant pour eux et pour nous car nous avons eu de ces pays des personnes remarquables. J’ai eu des relations systématiques avec des laboratoires à Prague, Cracovie, à Moscou, à Kiev, Novosibirsk, à Sofia. Avec la Roumanie, c’était impossible car Madame Ceaucescu interdisait aux scientifiques de discuter avec des étrangers.
Avec les pays en voie de développement, la situation change d’un pays à l’autre. J’ai eu des relations avec le Maroc parce que l’université de Bordeaux et l’université de Rabat avaient des liens traditionnels. Je suis allé y faire cours. Il y avait de très bons étudiants je les ai encouragés à faire une thèse. Le nombre a crû considérablement. 30 ou 35 Marocains ont fait des thèses avec moi. J’avais une politique de sélection impitoyable ; je prenais les meilleurs et je les surpayais. Je voulais qu’ils n’aient pas de souci matériel pendant leur thèse. J’ai eu des liens plus occasionnels avec la République du Congo et quelques Tunisiens mais ils préféraient Marseille.
Avec la Chine j’ai fait un choix politique. J’ai compris que la Chine était un potentiel économique et humain. La France devait être présente à un moment où la Chine était exclusivement tournée vers les Etats-Unis. Je suis allé souvent en Chine. J’ai fait venir des étudiants chinois en les choisissant bien sûr excellents. Mes espoirs ont été dépassés par le succès car ils ne sont pas retournés en Chine mais partis au Canada ou aux Etats-Unis comme professeurs ou dans l’industrie. Ils se sont bien débrouillés. Maintenant c’est différent ; une majorité d’étudiants chinois reviennent en Chine.
L’Inde est aussi un pays avec lequel j’ai eu des relations. C’est une société où le savoir est respecté, une science de caste malgré l’abolition officielle des castes. Thaïlande, Malaisie, Indonésie...j’ai privilégié les pays asiatiques par rapport aux pays africains car la culture asiatique favorise la réflexion métaphysique et par conséquent scientifique. Néanmoins j’ai eu aussi des collaborations avec le Brésil, le Chili et l’Argentine. Le but étant d’aider ces pays dans leur développement industriel. Je suis d’ailleurs membre de l’Académie des sciences brésilienne depuis 1988.
Vis à vis des étudiants du tiers monde, j’ai toujours considéré comme ma responsabilité de leur donner une thèse originale et non pas, comme on le fait souvent, de leur faire remplir des vides dans le laboratoire ou de servir de main d’œuvre. Les étudiants du tiers monde que l’on fait venir en Europe il faut bien les choisir et bien les former pour qu’ils deviennent des maîtres.
HA : Je serai curieux de connaître votre point de vue sur l’évolution de la chimie des matériaux et le rapprochement avec la biologie.
PH : Je ne me sens pas compétent dans l’interface chimie/biologie. Mais mon expérience à l’interface physique et chimie me rend plutôt sympathique cette perspective d’une ouverture de la chimie vers la biologie. Elle est défendue par Pierre Pottier, Guy Ourisson, Corriu.
Sur l’interface physique/chimie, cela s’est moins bien passé. Peut-être que je n’ai pas su convaincre. Quand on prêche, on se fait des adeptes mais aussi des ennemis. Cela est vrai au CNRS. Celui qui prêche secoue les caciques, les gens en place. Quelqu’un comme Fernand Gallais était fermement hostile à mon projet d’interface avec la physique. Par contre j’ai rencontré beaucoup de sympathies du côté de Pottier, de Jacques Livage.
Pour revenir aux oxydes supraconducteurs, il s’agit d’un cas intéressant de collaboration entre physiciens et chimistes. Très vite, j’ai compris que l’on avait plafonné et puis à un moment donné il était clair que Tc était d’autant plus élevé que la bande de conduction était plus étroite. Et plus la bande de conduction est étroite plus le matériau est instable et a tendance à se dismuter en donnant un mélange de deux phases. J’ai compris cela très vite mais beaucoup ne l’ont pas compris. Il y a donc eu un emballement. Il a rapproché les chimistes des physiciens. Il est dommage que personne n’ait proposé un modèle simple permettant aux chimistes d’innover de manière simple comme on avait innové dans le domaine de la conductivité ionique, du magnétisme, de la ferroélectricité, des magnéto-optiques ... ou même des composites thermo-structuraux. Il a manqué quelqu’un qui propose un modèle intuitif liant les propriétés à la liaison chimique. Goodenough aurait pu le faire mais il était trop vieux, trop pressé de publier des matériaux miracles. Les matériaux miracles sont difficiles à reproduire. Celui qui essaie il n’a pas le même four ... Ces matériaux sont métastables, ils ne sont jamais parfaitement purs. Ils n’ont jamais le même nombre de lacunes d’oxygène. Donc ce n’est jamais parfaitement répétitif. Cela exclut toute réplication sérieuse parce qu’un matériau n’est utilisable industriellement que s’il est relativement simple à préparer et à utiliser. Telle est la raison de l’échec de la diode Josephson sur laquelle IBM a dépensé beaucoup d’argent. A l’époque j’étais d’ailleurs conseiller d’IBM.
BBV : Est-ce qu’il y a eu des matériaux sortis de vote laboratoire qui ont été industrialisés ?
PH : Il y a d’abord eu les varistors. J’ai fait beaucoup avec la Thomson CSF dans ce domaine. Il y a eu LixCoO2 et puis il y a les céramiques composites de R. Naslain : fibres de carbone infiltrées par SiC qui permet de travailler à des hautes températures pour les matériaux de rentrée de la fusée ou du satellite dans l’atmosphère. Car lorsque l’engin revient dans l’atmosphère, il y a un risque d’oxydation. L’astuce consistait à infiltrer - non pas déposer en surface - SiC à partir d’une phase vapeur. Alors à l’air SiC s’oxyde en donnant SiO2 qui s’infiltre dans le matériau à base de carbone et permet de le prolonger.
BBV : Pourriez vous préciser quelles étaient vos relations avec l’industrie et comment elles ont évolué ?
PH : J’ai toujours eu des relations avec l’industrie. Quand j’étais à Rennes j’ai été contacté par Raymond Paul, un des responsables de la recherche à Rhône Poulenc et il m’a vivement encouragé à travailler avec Rhône Poulenc. J’ai eu plusieurs bourses de thèses payées par l’industrie - parfois il fallait publier des résultats plus tard. Rhône Poulenc a payé la thèse de Michel Pouchard sur les bronzes de vanadium au début des années 60. Ensuite il m’a paru tout naturel de travailler avec l’industrie. J’ai travaillé avec Saint-Gobain sur les verres, en particulier sur les verres conducteurs du lithium et du sodium avec Levasseur, sur les verres sulfurés à base de B2S3. Les verres sont un matériau merveilleux. Ils ont une composition qui est flexible. Vous tombez un peu à côté, cela n’a pas d’importance les propriétés ne sont guère modifiées. Vous n’avez pas le problème des matériaux cristallins où, par suite de la moindre erreur, de la moindre difficulté de préparation, une deuxième phase d’impuretés se forme à côté. Là il vous reste une phase. D’autant plus qu’on peut préparer les verres par trempe brutale donc énormément de matériaux sont vitreux alors qu’il y a 30 ou 40 ans c’était différent.
J’ai eu beaucoup de liens avec l’industrie locale : Aérospatiale et SNECMA, avec SNPA (société nationale des pétroles d’aquitaine : ancêtre d’Elf) sur comment purifier le gaz de Lacq...Ma porte était toujours ouverte, on élargissait le champ de nos recherches à la demande car l’industrie n’est pas un boulet.
BBV : Est-ce que ces liens étaient encouragés par le CNRS ?
PH : Le CNRS était informé bien sûr. Et puis quand on est devenu un laboratoire propre en 1966 Curien était très favorable aux relations avec l’industrie. On a un des contrats avec Saint-Gobain, avec Rhône Poulenc devenu Rhodia, avec Ugine Kuhlman devenu Péchiney. Nous avons même eu des liens avec General Electric aux USA pour les borures, avec BASF sur le di-oxyde de chrome pour les bandes d’enregistrement.
BBV : Quelles sont les méthodes et techniques utilisées dans votre laboratoire ? Et comment ont-elles évolué au cours de votre carrière ?
PH : Au début le B-A-BA c’était la diffraction X. Puis pour bien comprendre la structure on a eu un équipement pour des monocristaux. On a préparé des mono-cristaux pour déterminer les structures. Maintenant on a fait de gros progrès et on peut sur des spectres de poudres lorsque la poudre est de bonne qualité déterminer la structure par les méthodes Riedveld en faisant des hypothèses simples sur la structure la plus probable. La diffraction X a été fondamentale et a débouché ensuite sur la microscopie électronique en transmission qui permet de voir les défauts locaux. C’est merveilleux. La diffraction X était une méthode à grande distance. Par contre la microscopie électronique en transmission vous donne les défauts localisés et étendus. C’est une préoccupation que j’ai eu beaucoup à propos de non-stœchiométrie. Quand on passe d’une phase perovskite ABO3 à une phase brownmillérite A2B2O5, on perd de l’oxygène. Alors à haute température les lacunes d’oxygène sont désordonnées. A température plus basse, elles s’ordonnent en fonction du cation B. Quand c’est du fer ou du gallium, un cation isotrope, on a soit des tétraèdres parce qu’il y a pas de lacune, soit des octaèdres car les lacunes marchent par deux. Donc dans une structure brownmillérite on a une séquence octaèdre,-tétraèdre, octaèdre-tétraèdre, et dans la structure perovskite c’est octaèdre-octaèdre-octaèdre. Alors on peut trouver à condition de faire des recuits à température assez basse - quelques centaines de degrés - des phases intermédiaires avec 2 couches octaèdres, 1 couche tétraèdre, 3 couches octaèdres, 1 couche tétraèdre. Et bien sûr quand on chauffe le désordre s’installe à cause de l’entropie d’empilement. On a étudié de manière systématique comment on passe de défauts isolés aux défauts ordonnés, étendus. Et cela a des conséquences au point de vue de la conductivité de l’ion oxygène. Parce que maintenant on a de nouvelles préoccupations. On veut par exemple extraire l’oxygène de l’air par des membranes de perovskite lacunaire ou détruire les traces de CO en oxydant par l’eau. Dans ce cas, vous avez CO2 - qui est quand même moins toxique que CO, sauf sur le plan idéologique - et vous avez de l’hydrogène. On utilise des perovskites lacunaires qui doivent être conducteurs de l’oxygène - ce qui est normal - mais aussi conducteurs électroniques car le transfert se fait sous tension donc il faut que les ions O2- migrent à travers les lacunes de la structure. Il y a donc un aspect pratique pour les capteurs d’oxygène, la purification des gaz. Les Norvégiens utilisent ces méthodes massivement pour transformer le gaz de la Mer du Nord en un gaz exempt de CO. Norsk-Hydro dépense des sommes considérables pour cela. J’ai été invité pour parler avec les gens impliqués par ces recherches.
Donc pour résumer : nos efforts se sont situés à l’interface entre physique et chimie et se concentraient sur l’étude des relations entre composition, structure et propriétés avec la perspective d’applications industrielles.
Fin de l’enregistrement